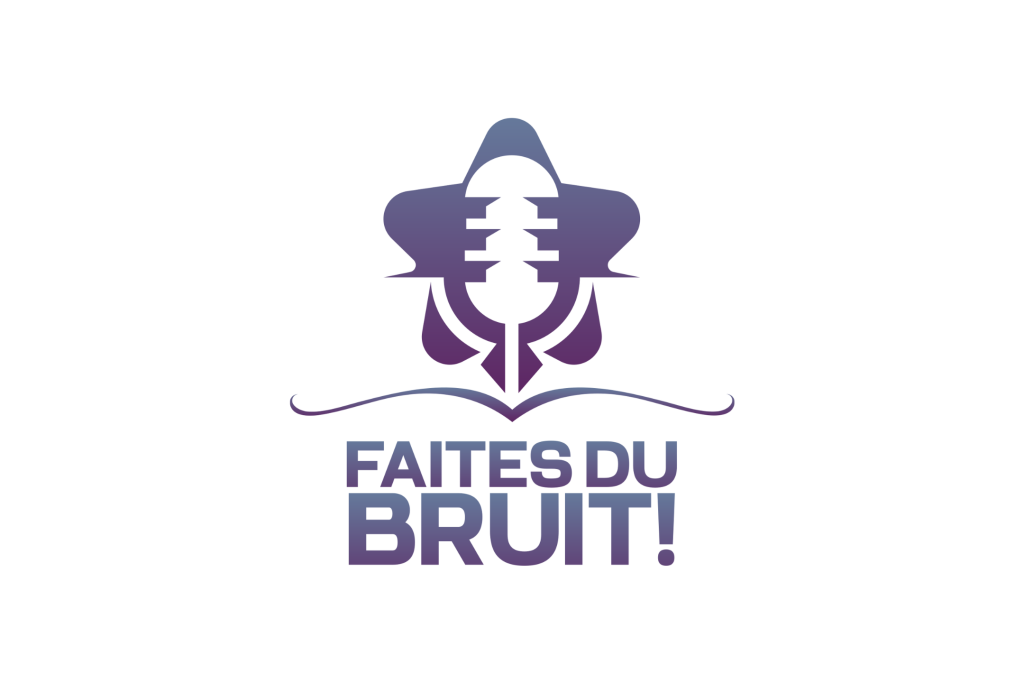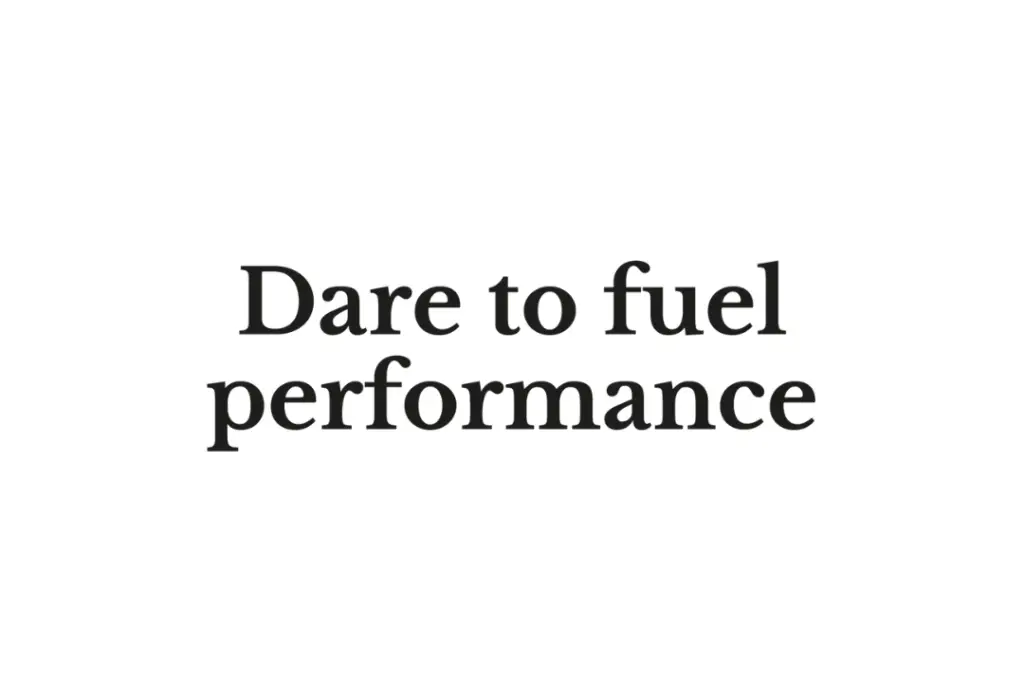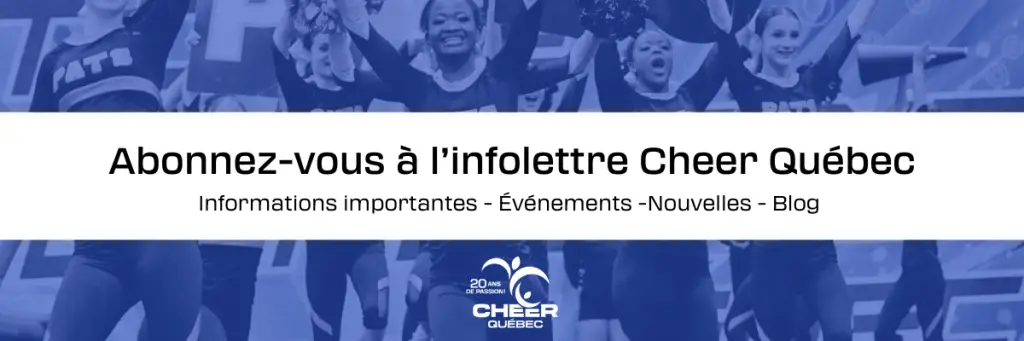Par l’équipe de Sport’Aide
Le sport, c’est bien plus qu’une activité physique. C’est une façon de rester en santé, de se faire des ami·e·s et d’apprendre des valeurs comme le respect, le travail d’équipe et la discipline. Pour plusieurs, c’est « l’école de la vie ». Malheureusement, ce n’est pas chaque personne qui vit une expérience positive dans le sport. En fait, la violence est beaucoup plus présente qu’on le pense et elle passe parfois inaperçue parce qu’on finit par la considérer comme normale.
Que ce soit de la violence physique, psychologique ou sexuelle, elle n’a pas sa place et ne devrait pas être tolérée dans le sport ou ailleurs. La violence peut avoir des conséquencesgraves, autant dans le moment présent qu’à plus long terme. Pour rendre les milieux sportifs sécuritaires et accueillants pour tout le monde impliqué dans le sport, il est important que chacun·e apprenne à la reconnaître et à en parler.
Reconnaître les différentes formes de violence
La violence physique
La violence physique se produit lorsqu’une personne frappe (avec la main, le pied ou un objet), secoue, pousse ou blesse intentionnellement une autre personne. La personne qui émet ces gestes peut être un·e athlète, un·e entraîneur·e, un parent ou toute autre personne impliquée dans l’organisation. Dans certains sports, les contacts physiques font partie du jeu (p. ex. plaquer ou pousser), mais ça ne veut pas dire que tous les contacts sont acceptables. Il est important de rester attentif·ve et de s’assurer que ces gestes soient bien encadrés par les règles du sport et de l’organisation. Si ces contacts sortent du cadre sportif ou dépassent ce qui est normal pour la situation, il faut agir.
La violence sexuelle
La violence sexuelle se produit lorsqu’une personne agit ou tente d’agir de manière sexuelle envers quelqu’un, sans son consentement libre et éclairé, ou envers une personne incapable de dire oui ou non (p. ex. consommation d’alcool, utilisation de la menace, limitations intellectuelles, perte de conscience). Elle peut inclure des gestes physiques, comme avoir ou tenter d’avoir des relations sexuelles, toucher une personne de façon inappropriée ou encore caresser sans consentement. Elle peut aussi se manifester sans contact physique, soit par des paroles à caractère sexuel, de l’exploitation sexuelle (p. ex. prostitution) ou des comportements comme le voyeurisme (observer une personne nue ou dans son intimité) ou l’exhibitionnisme (s’exposer de manière inappropriée). Les comportements à caractère sexuel inappropriés qui se produisent en ligne ou sur les applications sont également inacceptables.
Au Canada, si une personne est en position d’autorité (p.ex. un·e entraîneur·e par rapport à l’athlète), l’âge minimum pour consentir à une activité sexuelle est de 18 ans, et non 16 ans. Cela veut dire que tout acte sexuel entre une personne en position d’autorité et un·e athlète mineur·e est illégal, même si l’athlète croit être d’accord avec la situation.
La violence psychologique
La violence psychologique est généralement utilisée pour contrôler l’autre, lui faire peur, l’isoler ou lui ôter sa dignité. Dans le sport, il s’agit de la forme de violence que l’on retrouve le plus souvent. Selon des études, entre 60% et 79% des athlètes en auraient été victimes, ce qui est très préoccupant. Si elle est autant fréquente, c’est qu’elle est difficile à reconnaître et qu’on la considère souvent comme normale.
Plusieurs comportements sont considérés comme de la violence psychologique, même si la personne qui les fait n’en est pas consciente. Ces comportements sont souvent utilisés dans le but de « motiver » les athlètes à performer, alors qu’ils sont plutôt nuisibles.
Voici des exemples de comportements de violence psychologique souvent normalisés en sport :
Forcer ou obliger un·e athlète à :
- Réaliser des entraînements jusqu’à l’épuisement ou jusqu’à ce qu’il·elle vomisse ;
- S’entraîner malgré une blessure, alors qu’il·elle a reçu un avis médical contraire ;
- Réaliser des mouvements ou des techniques trop difficiles pour ses capacités, le·lamettant à risque de blessure ;
- Adopter des comportements alimentaires malsains pour atteindre le poids idéal dans son sport.
Forcer ou demander à un·e athlète de :
- Commettre des actes de violence, tel que blesser ou menacer de blesser un·e autre athlète, humilier ou ridiculiser un·e autre athlète ;
- Consommer des produits dopants ;
- Limiter déraisonnablement ses interactions sociales (p. ex. partenaires amoureux, ami·e·s, famille).
Autres comportements :
- Menacer d’abandonner l’athlète ;
- Lancer des objets dans la direction de l’athlète ou menacer de le faire ;
- Crier sur l’athlète, l’humilier ou le·la ridiculiser ;
- Être extrêmement critique envers un·e athlète.
Quoi faire si tu es victime ou témoin de violence?
Athlètes
Il peut être difficile de parler d’une situation de violence dont tu es victime ou témoin, mais c’est une étape importante à franchir pour obtenir de l’aide. Tu peux commencer par en parler à une personne en qui tu as confiance, comme un parent, un·e entraîneur·e ouun·e intervenant·e sportif·ve. Ces personnes sont disponibles pour t’écouter, te soutenir et t’accompagner.
Si tu préfères en parler à une personne plus neutre, tu peux contacter Sport’Aide. Leur équipe est là pour t’écouter et te diriger vers les ressources qui pourront t’aider. Tu n’as pas à traverser ça seul·e, il y a toujours quelqu’un prêt à t’aider !
Adulte
En tant qu’adulte, vous avez le devoir de signaler les comportements de violence envers un·e mineur·e, que vous en soyez témoin ou que vous ayez un soupçon qu’ils se soient produits. Cette violence peut avoir des conséquences importantes sur la victime, d’où l’importance d’agir rapidement lorsqu’elle survient.
Si un·e jeune se confie à vous au sujet d’une situation qu’il·elle a vécu, c’est qu’il·elle a confiance en vous et qu’il·elle a besoin de votre soutien. La meilleure chose que vous pouvez faire est de l’écouter, de le·la croire et de le·la rassurer qu’il·elle a bien fait d’en parler. Assurez-lui que vous serez présent·e pour l’accompagner dans les prochaines étapes.
Il est également essentiel de respecter son rythme et de l’impliquer dans chaque décision. Ceci permet d’éviter de le·la brusquer et permet de préserver son sentiment de contrôle sur la situation.
Qui contacter pour obtenir de l’aide?
Sport’Aide
Les intervenant·e·s du service d’aide et d’accompagnement sont disponibles pour vous écouter, vous proposer des pistes de solution et vous accompagner dans votre processus de plainte, au besoin. Il est important de noter que Sport’Aide ne traite pas les plaintes.
Si vous souhaitez trouver la bonne ressource pour vous ou un·e athlète, vous pouvez nous contacter. Nous répondrons à vos questions et vous référerons vers la meilleure ressource possible.
Voici nos différents canaux de communication :
- Téléphone : 1-833-211-2433 (lundi au dimanche, 24h/24)
- SMS : Textez au 1-833-211-2433 (lundi au vendredi de 8h-21h30 et la fin de semaine de 10h-17h)
- Courriel : aide@sportaide.ca (lundi au vendredi de 8h-21h30 et la fin de semaine de 10h-17h)
- Facebook : Organisme Sport’Aide (lundi au vendredi de 8h-21h30 et la fin de semaine de 10h-17h)
- Clavardage : Disponible sur le site Internet de Sport’Aide (lundi au vendredi de 8h-21h30 et la fin de semaine de 10h-17h)
- Demande d’aide en ligne : Sport’Aide – Service d’accompagnement (sportaide.ca)
L’organisation sportive
Vous pouvez contacter votre organisation sportive lorsqu’il s’agit d’un manquement au code de conduite du club. En ce qui concerne des gestes de violence sexuelle ou physique, veuillez vous référer aux instances ci-dessous.
L’Officier des plaintes
Lorsque vous êtes témoin ou victime d’une situation de violence ou que votre jeune en a été victime, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’Officier des plaintes. Il suffit de remplir le formulaire du bouclier vert « Je porte plainte », disponible sur le site de votre fédération dans l’onglet « sport sécuritaire ».
Prendre note que l’Officier des plaintes peut devoir contacter le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans certaines situations si la loi le prévaut et qu’un·e mineur est impliqué·e.
Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)
Vous devez contacter le DPJ lorsque vous avez un doute raisonnable de croire que la sécurité et/ou le développement d’un·e mineur·e est compromis. Si vous hésitez à faire un signalement, veuillez contacter le DPJ. Un·e intervenant·e pourra répondre à vos questions et vous guider au besoin.